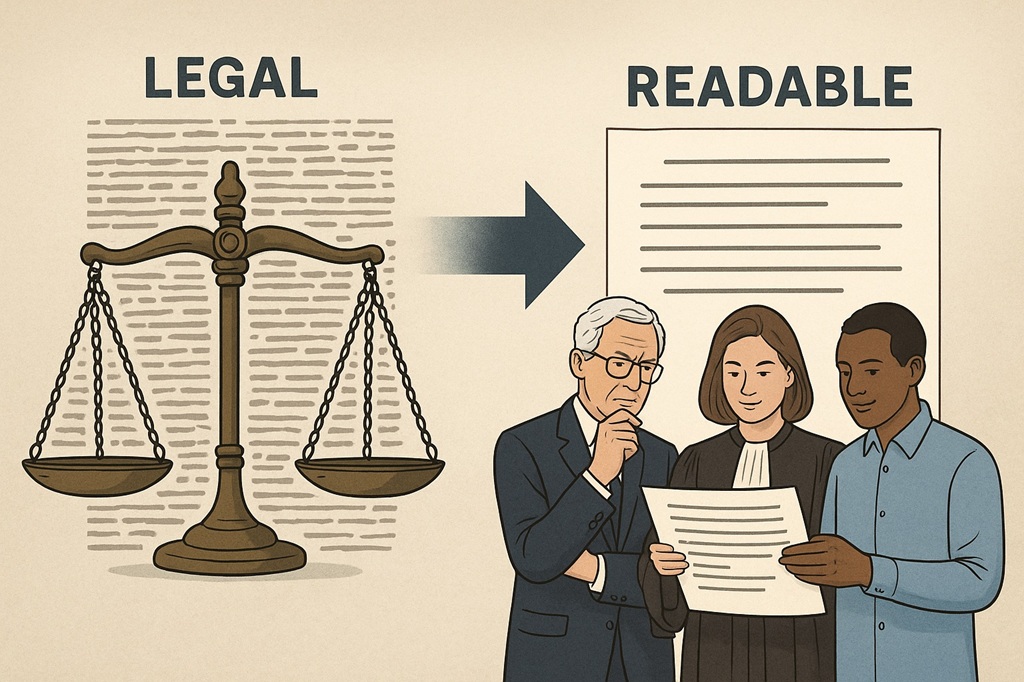
Introduction : quand la loi perd ses lecteurs
Depuis des siècles, les textes de loi et les contrats se caractérisent par un style alambiqué, une syntaxe interminable et un vocabulaire ésotérique, que l’on regroupe sous un terme ironique mais redoutablement exact : le « juridiquois », ou legalese en anglais. Les juristes s’en réclament parfois comme d’un signe distinctif de rigueur et de précision. Mais au-delà de cette image d’autorité, un problème persistant demeure : ce langage est incompréhensible non seulement pour le profane, mais aussi — comble de l’ironie — pour les juristes eux-mêmes.
Un article récent publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, 2023) a confirmé ce que beaucoup pressentaient : le juridiquois n’est pas seulement obscur pour le grand public, il nuit également à la compréhension et à la mémorisation des avocats. Ces derniers, confrontés à des clauses écrites en style simplifié, obtiennent de meilleurs résultats cognitifs que face aux formulations classiques. Dès lors, une question cruciale surgit : si ce langage dessert tout le monde, pourquoi persiste-t-il encore ?
Le « juridiquois » : héritage historique ou outil de pouvoir ?
Le langage juridique complexe n’est pas né par hasard. Ses racines plongent dans l’histoire du droit, à l’époque où l’on mêlait latin, normand et vieil anglais dans les tribunaux. Les redondances et les tournures alambiquées traduisaient alors un effort pour couvrir toutes les éventualités, éviter les contestations et donner à l’écrit une solennité presque sacrée.
Avec le temps, ces habitudes sont devenues des conventions, puis des réflexes. Les générations de juristes se sont transmises non seulement des règles, mais aussi des manières de les formuler. Résultat : au XXIe siècle, il n’est pas rare de lire des phrases de 80 mots, truffées de termes techniques et de doublons tels que « null and void » ou « cease and desist », qui auraient déjà fait sourire un grammairien du XIXe siècle.
Certains y voient une stratégie implicite de différenciation : créer un langage inaccessible pour asseoir une forme de monopole. Plus le texte est complexe, plus il faut recourir à un professionnel pour le déchiffrer. Mais cette hypothèse, séduisante pour la critique sociale, ne suffit pas. Les données expérimentales montrent que même les avocats trouvent ce langage contre-productif. Il s’agit donc moins d’une conspiration que d’une inertie culturelle.
Les preuves expérimentales : quand la science teste le droit
L’étude publiée dans PNAS s’appuie sur deux expériences simples mais éloquentes. Dans la première, des avocats et des non-juristes ont dû lire des textes rédigés en langage juridique traditionnel, puis les mêmes textes reformulés en anglais clair. Résultat : la compréhension et la mémoire étaient systématiquement meilleures avec la version simplifiée, et ce pour les deux groupes. Le constat est donc universel : le jargon juridique freine la cognition.
La deuxième expérience a exploré la perception qualitative. Les participants devaient évaluer la crédibilité, la force contraignante et la valeur stylistique des textes. Surprise : les versions simplifiées n’étaient pas jugées moins sérieuses ni moins « juridiquement valides ». Au contraire, elles étaient perçues comme plus élégantes et plus susceptibles d’être acceptées par un client. En d’autres termes, simplifier n’enlève rien à l’autorité d’un texte, bien au contraire.
Ces résultats battent en brèche l’idée que la complexité garantirait la robustesse juridique. Ce qui semblait être un atout (la précision par la lourdeur) apparaît plutôt comme un handicap cognitif généralisé.
Pourquoi le juridiquois survit-il malgré tout ?
Si les juristes eux-mêmes reconnaissent la supériorité du langage clair, pourquoi persiste-t-on à enseigner, écrire et publier dans un style qui décourage la lecture ? Plusieurs hypothèses ont été avancées.
La première est celle de la tradition. Les contrats modernes sont souvent rédigés à partir de modèles anciens, copiés-collés et transmis d’un cabinet à l’autre. Modifier ces modèles suppose du temps, de la formation et parfois la crainte d’omettre une clause jugée essentielle.
La deuxième est celle de la sécurité psychologique. Dans un univers où chaque mot peut être interprété par un juge, multiplier les formulations redondantes donne l’illusion d’une protection accrue. Mieux vaut trop que pas assez, même si l’ensemble devient indigeste.
Enfin, la troisième est celle de l’identité professionnelle. Parler une langue différente, difficile d’accès, permet aux juristes de se distinguer des profanes, de cultiver un entre-soi intellectuel. C’est une marque d’appartenance, un peu comme l’argot des étudiants en médecine ou le jargon des chercheurs.
Pourtant, aucune de ces justifications ne résiste vraiment à l’analyse. Ni la tradition, ni la sécurité, ni l’identité n’empêchent de simplifier sans rien perdre en force juridique. Le maintien du juridiquois relève donc avant tout d’une habitude collective, entretenue par l’inertie institutionnelle.
Les conséquences pratiques : incompréhension et inefficacité
Les effets de ce langage dépassent le simple inconfort du lecteur. Dans la vie réelle, un contrat mal compris peut avoir des conséquences majeures : litiges, mauvaise exécution des clauses, défiance envers les institutions. Lorsque même les avocats reconnaissent qu’ils comprennent mieux un texte simplifié, il devient difficile de justifier la persistance d’un langage opaque.
Du côté des clients, l’effet est encore plus marqué. Face à un contrat rédigé en jargon juridique, la majorité signe sans comprendre, par confiance ou par résignation. Cela crée un déséquilibre informationnel entre professionnels et profanes, contraire à l’esprit même de la transparence démocratique et du droit à l’information.
Enfin, sur le plan judiciaire, des clauses mal comprises peuvent alimenter des contentieux inutiles. Simplifier le langage n’est donc pas seulement une question d’accessibilité : c’est une mesure d’efficacité, de réduction des coûts et de prévention des conflits.
Vers une révolution linguistique dans le droit ?
L’étude du PNAS montre que le changement est possible et même souhaité par les professionnels eux-mêmes. La question est alors de savoir comment amorcer cette transformation. Une piste consiste à réformer l’enseignement du droit : apprendre aux étudiants à rédiger non seulement avec rigueur, mais aussi avec clarté. La précision n’est pas incompatible avec la simplicité, contrairement à une idée reçue.
Une autre piste réside dans la pression sociale et institutionnelle. Les gouvernements, les ONG, les associations de consommateurs réclament de plus en plus la transparence des contrats, notamment dans les domaines sensibles comme la santé, la banque ou le numérique. L’essor du mouvement « plain language » aux États-Unis et en Europe traduit cette exigence croissante.
Enfin, la transformation pourrait venir du marché lui-même. Les clients, mieux informés, préféreront confier leurs affaires à des avocats capables de produire des contrats lisibles. De la même manière que l’ergonomie est devenue un critère incontournable dans le design numérique, la lisibilité pourrait devenir un argument commercial dans le monde juridique.
Discussion : entre science cognitive et pragmatisme juridique
Au-delà de l’anecdote, cette recherche illustre une vérité fondamentale : la cognition humaine a ses limites. Notre mémoire de travail est incapable de gérer efficacement des phrases interminables et des redondances absurdes. Le langage juridique, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, exploite ces limites au lieu de les respecter.
En introduisant des données expérimentales dans le débat, les auteurs de l’étude changent la donne : la critique du juridiquois n’est plus seulement une posture littéraire ou politique, elle devient un constat scientifique. Les avocats qui persisteraient à défendre ce style ne pourraient plus invoquer l’argument de la nécessité juridique, mais seulement celui de la paresse ou de l’habitude.
La réforme du langage juridique apparaît donc non seulement possible, mais inévitable à long terme. Reste à savoir si la profession saura prendre ce virage volontairement ou si elle y sera contrainte par des pressions externes.
Conclusion : sortir du brouillard linguistique
Le juridiquois est une relique qui survit plus par inertie que par nécessité. Les preuves scientifiques sont désormais claires : il complique la compréhension, il nuit à la mémoire, et il n’ajoute rien à la validité des textes. Les juristes eux-mêmes reconnaissent qu’un langage clair est plus efficace, plus élégant et plus acceptable pour leurs clients.
Alors, pourquoi attendre ? Comme dans tant d’autres domaines, l’innovation ne consiste pas ici à inventer de nouvelles technologies, mais à redécouvrir une évidence : un texte que tout le monde comprend est un texte plus juste.
Peut-être qu’un jour, les manuels de droit commenceront leurs chapitres non par « Whereas… » mais par « Considérant que… », rédigé en phrases simples. Et peut-être que, ce jour-là, le droit cessera d’être un brouillard réservé aux initiés pour redevenir ce qu’il aurait toujours dû être : une langue au service de tous.
FAQ
1. Le langage juridique complexe est-il nécessaire pour garantir la précision des textes ?
Non. Les études montrent que la simplification n’enlève rien à la force juridique. Au contraire, elle améliore la compréhension sans réduire la rigueur.
2. Pourquoi les juristes continuent-ils à écrire de manière compliquée ?
Principalement par habitude, par tradition et par peur de l’oubli d’une clause. Mais aucune de ces raisons ne justifie objectivement le maintien d’un langage inutilement opaque.
3. Le changement est-il possible ?
Oui. Il passe par la réforme de l’enseignement du droit, la pression sociale en faveur de la transparence, et l’adoption volontaire du « plain language » par les praticiens.